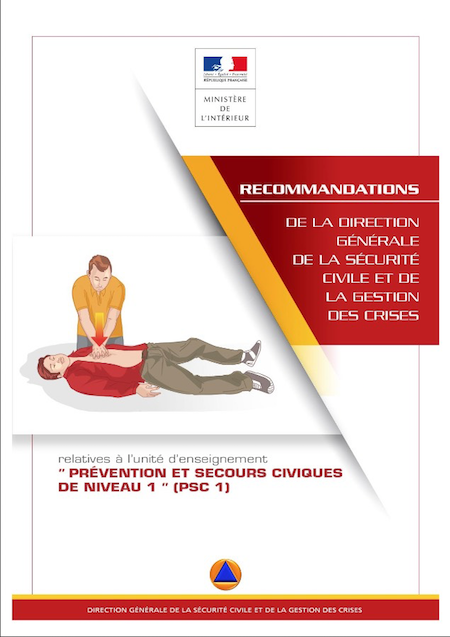Recommandations PSC1 décembre 2016
6 janvier 2017 - dernière mise à jour 22 janvier 2023
Avertissement Contenu obsolète. Les documents de cette page ne sont plus d'actualité en France. Ils ne sont fournis qu'à titre d'archive.
Ces recommandations sont destinées à faciliter l’action des organismes habilités et des associations nationales agréées. Elles permettent de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires pour les gestes de secours, selon une approche scientifique conforme aux recommandations des sociétés savantes.
Disponible en version ePub pour lecture sur smartphone et liseuse.
En complément le ministère de l’Intérieur a publié un guide qui apporte à l’ensemble des formateurs les justifications particulières et notamment scientifiques sur une majorité de modifications intervenues dans cette nouvelle version des recommandations.
Disponible à l’achat en couverture souple au format A5 économique, impression noir et blanc : http://www.lulu.com/shop/dgscgc/rec...
Texte intégral
Ministère de l’Intérieur
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Localisation géographique : 18, rue des Pyrénées 75020 Paris
Adresse postale : Place Beauveau — 75008 Paris
AVERTISSEMENT — Le présent guide est une version fournie au format HTML. La conversion depuis le fichier PDF original a été réalisée par secourisme.net. Malgré le soin apporté à sa réalisation des erreurs peuvent subsister, dans ce cas merci de les signaler à webmaster chez secourisme.net.
Recommandations relatives à l’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1)
L’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » a pour objectif de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours, conformément aux dispositions en vigueur.
Cette unité d’enseignement est dispensée à partir d’un référentiel interne de formation et de certification établi par l’organisme habilité ou l’association nationale agréée à la formation aux premiers secours au titre duquel le formateur intervient.
Les informations figurant dans le présent document sont destinées à faciliter l’action des organismes habilités et des associations nationales agréées à la formation aux premiers secours, en leur permettant de disposer de l’ensemble des éléments de langage nécessaires à justifier l’emploi des techniques relatives aux gestes de premiers secours, selon une approche scientifique conforme aux recommandations des sociétés savantes.
LÉGENDE
Dans le cadre de l’actualisation des recommandations, certaines fiches ont fait l’objet de modifications, ce qui nécessite la publication d’une nouvelle version.
La numérotation de celles-ci doit faciliter les organismes habilités et les associations agréées à la formation aux premiers secours de diffuser, de façon simplifiée, les nouveaux contenus de ces fiches à leurs formateurs pour qu’ils puissent prendre connaissance des modifications à mettre en œuvre lors des actions de formation.
A titre d’information, la numérotation des versions est définie comme suit :
– Lorsque le premier chiffre est modifié, il s’agit de changements nécessitant une formation spécifique pratique des formateurs, par exemple, dans le cadre d’une formation continue selon la période de publication de ces recommandations ;
VERSION 1.1.1 DEVIENT 2.1.1
– Lorsque le chiffre situé au milieu est modifié, il s’agit de changements nécessitant une information des formateurs par l’autorité d’emploi ;
VERSION 1.1.1 DEVIENT 1.2.1
– Lorsque le dernier chiffre est modifié, il s’agit de changements mineurs et portent sur de la tournure de phrase, correction orthographique notamment.
VERSION 1.1.1 DEVIENT 1.1.2 OU 1.1.3
Afin de suivre, à long terme, la publication des fiches procédures et techniques, vous trouverez dans le suivi des mises à jour, le tableau permettant de s’assurer de la version actuelle.
SUIVI DES MISES À JOUR
| Version | actuelle | antérieure |
|---|---|---|
| ALERTE | 1.1.2 | 1.1.1 |
| ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS | 1.2.1 | 1.1.1 |
| ARRÊT CARDIAQUE | 1.2.1 | 1.1.1 |
| BRÛLURES | 1.1.2 | 1.1.1 |
| HÉMORRAGIES EXTERNES | 2.1.1 | 1.1.1 |
| MALAISE | 1.2.1 | 1.1.1 |
| OBSTRUCTION AIGUË DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER | 1.1.2 | 1.1.1 |
| PERTE DE CONNAISSANCE | 1.1.2 | 1.1.1 |
| PLAIES | 1.2.1 | 1.1.1 |
| PROTECTION | 1.2.1 | 1.1.1 |
| TRAUMATISME | 2.1.1 | 1.1.1 |
| TECH 1 COMPRESSION LOCALE | 1.2.1 | 1.1.1 |
| TECH 2 COMPRESSIONS THORACIQUES | 1.2.1 | 1.1.1 |
| TECH 3 DÉFiBRILLATION | 1.1.2 | 1.1.1 |
| TECH 4 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES CLAQUES DANS LE DOS | 1.2.1 | 1.1.1 |
| TECH 5 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES COMPRESSIONS ABDOMINALES | 1.1.2 | 1.1.1 |
| TECH 6 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES COMPRESSIONS THORACIQUES | 1.2.1 | 1.1.1 |
| TECH 7 GARROT | 2.1.1 | Néant |
| TECH 8 INSUFFlATIONS | 1.1.2 | 1.1.1 |
| TECH 9 LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES | 1.1.2 | 1.1.1 |
| TECH 10 MAINTIEN DE LA TÊTE | 2.1.1 | Néant |
| TECH 11 POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ | 1.2.1 | 1.1.1 |
| MAT 1 DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE | 1.1.3 | 1.1.2 |
ALERTE
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Présentation
L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’urgence de la présence d’une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que de la nature de l’assistance qui leur est apportée.
L’absence d’information d’un service d’urgence peut compromettre la vie ou la santé d’une victime malgré les gestes de premiers secours assurés par un sauveteur. Le rôle du sauveteur dans l’alerte est donc essentiel.
L’alerte doit être transmise, par le sauveteur ou un témoin, par les moyens disponibles les plus appropriés. Elle doit être rapide et précise afin de diminuer au maximum les délais de mise en œuvre de la chaîne de secours et de soins.
L’alerte doit être réalisée, après une évaluation rapide de la situation, des risques et une éventuelle mise en sécurité des personnes, auprès d’un numéro d’urgence gratuit :
– le 18, numéro d’appel des sapeurs-pompiers, en charge notamment des secours d’urgence aux personnes, des secours sur accidents, incendies ;
– le 15, numéro d’appel des SAMU, en charge de la réponse médicale, des problèmes urgents de santé et du conseil médical ;
– le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence et valide dans l’ensemble de l’Union Européenne.
Les secours peuvent conserver l’appelant au téléphone pour le conseiller ou le guider dans l’exécution de gestes, jusqu’à leur arrivée.
Conduite à tenir
Contacter un service d’urgence à l’aide d’un téléphone portable ou à défaut d’un téléphone fixe ou d’une borne d’appel :
– transmettre les informations ;
– répondre aux questions posées par les services de secours ;
– appliquer les consignes données ;
– raccrocher, sur les instructions de l’opérateur.
Les informations minimales à transmettre sont :
– le numéro de téléphone ou de la borne à partir duquel l’appel est passé ;
– la nature du problème : maladie, accident… ;
– la localisation la plus précise possible de l’évènement.
Lorsque le sauveteur demande à une autre personne de donner l’alerte, il convient :
– avant l’alerte, de s’assurer qu’elle possède tous les éléments ;
– après l’alerte, de vérifier qu’elle a correctement exécuté l’action.
Si possible, envoyer une personne pour accueillir les secours et organiser leur accès sur le lieu de l’accident, au plus près de la victime.
ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Principes d’organisation
L’alerte aux populations est une mesure exceptionnelle, dont l’efficacité repose sur une connaissance préalable des risques particuliers auxquels les populations sont exposées. Chaque citoyen peut se renseigner sur les risques qui l’entourent sur le site www.prim.net (ma commune face aux risques).
L’alerte est diffusée par le SAIP (Système d’Alerte et d’Information des Populations) qui est un ensemble d’outils permettant d’alerter la population de la survenance d’une crise grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions ou encore grâce à l’application mobile SAIP.
D’autres outils permettent également de diffuser de l’information ou d’alerter la population comme les panneaux à messages variables des communes, des autoroutes…
Le premier volet du SAIP est l’alerte des populations qui consiste à diffuser un signal destiné à avertir les individus d’un danger imminent ou qu’un évènement grave, en train de produire ses effets et susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique. Il se compose de deux codes distincts :
– le SNA (Signal National d’Alerte) : variation du signal sur trois cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes ;
– le signal de fin d’alerte : signal continu de 30 secondes.
La diffusion de ces signaux repose sur un réseau d’environ 5 300 sirènes permettant, de jour comme de nuit, d’attirer rapidement l’attention des populations pour les appeler à réagir.
Des essais de ce réseau se déroulent le premier mercredi de chaque mois, à midi. Ils permettent à la population d’être capable d’identifier clairement le signal. Lors de ces essais mensuels, le signal émis est une variation sur un cycle restreint de 30 secondes, pour ne pas être confondu avec le SNA.
Par ailleurs, lorsqu’il existe des risques particuliers (chimiques, radioactifs…) et afin de prévenir les populations concernées, des systèmes d’alerte adaptés sont mis en place afin de pouvoir diffuser un signal.
Le déclenchement du SNA appelle une réaction immédiate de la population afin d’assurer sa mise à l’abri, son information ainsi que son confinement ou son évacuation.
Le deuxième volet du SAIP est l’information qui est primordial pour que les populations adoptent les comportements de sauvegarde adéquats. Elle repose notamment sur les sites et comptes des réseaux sociaux du gouvernement, du ministère de l’intérieur et des préfectures, sur les panneaux à messages variables ou encore sur l’application mobile SAIP gratuitement téléchargeable.
Pour s’assurer de la bonne diffusion de ces messages d’information, des conventions de partenariat ont également été signées par le ministère de l’intérieur avec Radio France et France Télévisions. Les messages diffusés visent à informer les populations sur la nature de l’événement et à délivrer des consignes de comportement précises à suivre impérativement. Pour plus d’efficacité, chaque zone et chaque département déclinent localement les conventions avec ces partenaires présents sur leur territoire.
Cas particulier
Seuls les dispositifs d’alerte propres aux aménagements hydrauliques émettent un signal distinct en cas de danger (corne de brume). Il s’agit alors d’un signal d’évacuation.
Conduite à tenir
La population doit être sensibilisée aux bons comportements en amont afin d’avoir la réaction adaptée dès le déclenchement du signal national d’alerte et jusqu’au signal de fin d’alerte. Ainsi, « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile » conformément à l’article L721-1 du code de la sécurité intérieure.
Les comportements de sauvegarde sont les suivants :
– se mettre en sécurité, rejoindre sans délai un bâtiment ;
– s’informer sur France Bleu, France Info, radios locales, France Télévisions, les sites et comptes des réseaux sociaux du gouvernement, du ministère de l’intérieur et des préfectures ;
– respectez les consignes des autorités et en fonction du type de risque, il peut être demandé de se confiner ou d’évacuer.
Pour se confiner, il convient :
– de fermer les portes et fenêtres ;
– de calfeutrer les portes, les fenêtres et les bouches d’aération ;
– d’arrêter les systèmes de ventilation ou de climatisation.
En cas d’évacuation, emportez votre kit d’urgence préparé à l’avance.
Dans tous les cas :
– restez en sécurité et n’allez pas chercher vos enfants à l’école car ils y sont protégés par leurs enseignants ;
– ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale pour laisser les réseaux disponibles pour les services de secours.
Pour en savoir plus et compléter votre kit :
– http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC
– http://www.gouvernement.fr/risques
ARRÊT CARDIAQUE
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition —
Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d’une façon anarchique, ne permettant plus d’assurer l’oxygénation du cerveau.
Signes
Une victime est considérée comme étant en arrêt cardiaque lorsqu’elle ne répond pas, ne réagit pas, et :
– ne respire pas : aucun mouvement de la poitrine n’est visible et aucun bruit ou souffle n’est perçu ;
– ou présente une respiration anormale avec des mouvements respiratoires inefficaces, lents, irréguliers et bruyants (gasps).
Causes
L’arrêt cardiaque peut être causé par certaines maladies du cœur, la principale est l’infarctus du myocarde. Chez l’adulte, dans près de 50 % des cas, cet arrêt cardiaque survient brutalement, en dehors de l’hôpital et est souvent lié à une anomalie de fonctionnement électrique du cœur : la fibrillation ventriculaire.
L’arrêt cardiaque peut aussi être consécutif à une détresse circulatoire (hémorragie, brûlure grave), à une obstruction totale des voies aériennes, une intoxication, un traumatisme ou une noyade.
Risques
Le risque d’un arrêt cardiaque est la mort de la victime en quelques minutes. En effet, l’apport d’oxygène est indispensable, en particulier au niveau du cerveau et du cœur, pour assurer sa survie. Au cours d’un arrêt cardiaque, les lésions du cerveau, consécutives au manque d’oxygène, surviennent dès la première minute.
Principes d’action
Le sauveteur doit réaliser une série d’actions pour augmenter les chances de survie de la victime :
– ALERTER : alerter de façon précoce les secours ;
– MASSER : pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) précoce ;
– DÉFIBRILLER : assurer la mise en œuvre d’une défibrillation précoce.
Ces différentes étapes constituent une chaîne de survie susceptible d’augmenter de 4 à 40 % le taux de survie des victimes. Chaque minute gagnée dans la mise en place d’une RCP efficace peut augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.
Conduite à tenir
– rechercher l’absence de réponse et pour cela :
- poser des questions simples (« Comment ça va ? », « Vous m’entendez ? ») ;
- secouer doucement les épaules ou lui prendre la main et demander d’exécuter un ordre simple (« serrez-moi la main »…).
En l’absence de réponse ou de réaction de la part de la victime :
– l’allonger sur le dos ;
– libérer les voies aériennes sans perdre de temps ;
– apprécier la respiration sur 10 secondes au plus. Pour cela :
- maintenir la libération des voies aériennes ;
- se pencher sur la victime, oreille et joue du sauveteur au-dessus de la bouche et du nez de la victime puis :
- regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
- écouter d’éventuels sons provoqués par la respiration ;
- sentir un éventuel flux d’air à l’expiration.
En l’absence de respiration, en présence d’une respiration anormale (gasps) ou en cas de doute :
… un tiers est présent :
– faire alerter les secours [1] et réclamer un DAE ;
– débuter immédiatement une RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. Le service de secours appelé pourra aider le sauveteur à la réalisation de la RCP, en donnant des instructions téléphoniques ;
– faire mettre en œuvre ou mettre en œuvre un DAE le plus tôt possible et suivre ses indications ;
– poursuivre la réanimation entreprise jusqu’au relais par les services de secours.
… aucun tiers n’est présent :
– alerter les secours, de préférence avec son téléphone portable. Le mettre sur le mode haut-parleur et débuter immédiatement la RCP en attendant que les services de secours répondent ;
– pratiquer la RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. Le service de secours appelé pourra aider le sauveteur à la réalisation de la RCP, en donnant des instructions téléphoniques ;
– si un DAE est visible [2], le mettre en œuvre le plus tôt possible et suivre ses indications vocales en interrompant le massage cardiaque le moins possible ;
– poursuivre la RCP entreprise jusqu’au relais par les services de secours.
Dans tous les cas :
– si les insufflations ne peuvent pas être effectuées (répulsion, vomissements…) ou si le sauveteur ne se sent pas capable, il doit réaliser uniquement les compressions thoraciques en continu à un rythme de 100 à 120 compressions/min ;
– en présence de plusieurs sauveteurs, relayer le sauveteur qui réalise les compressions thoraciques toutes les 2 minutes en interrompant le moins possible les compressions thoraciques (en cas d’utilisation d’un DAE, le relai sera réalisé pendant l’analyse).
BRÛLURES
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives. Elle est qualifiée de :
– brûlure simple, lorsqu’il s’agit de rougeurs de la peau chez l’adulte ou d’une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime ;
– brûlure grave, dès lors que l’on est en présence :
- d’une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime ;
- d’une destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois indolore) associée souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue ;
- d’une brûlure dont la localisation est sur le visage ou le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels ;
- d’une rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple) de la peau chez l’enfant ;
- d’une brûlure d’origine chimique, électrique ou radiologique.
Causes
La brûlure peut être provoquée par la chaleur, des substances chimiques, l’électricité, le frottement ou des radiations.
Risques
Suivant l’étendue, la profondeur et la localisation, la brûlure peut entraîner :
– un danger immédiat comme une défaillance circulatoire (en cas de brûlure étendue) ou respiratoire (lors d’une brûlure au visage, au cou ou consécutive à l’inhalation de fumée) ;
– une douleur sévère ;
– des conséquences retardées comme l’infection, les séquelles fonctionnelles ou esthétiques.
Principes d’action
Le sauveteur doit identifier la gravité et la nature de la brûlure afin d’adopter la conduite à tenir adaptée.
Conduite à tenir
– refroidir la surface brûlée par ruissellement d’eau du robinet tempérée immédiatement1. Débuter l’arrosage après 30 minutes n’a pas d’intérêt ;
– en parallèle, retirer les vêtements, s’ils n’adhèrent pas à la peau ;
– évaluer la gravité de la brûlure, puis…
… face à une brûlure grave :
– faire alerter ou alerter les secours dès le début de l’arrosage ;
– poursuivre le refroidissement, selon les consignes données ;
– installer en position adaptée, après refroidissement :
- allongée confortablement (lit, canapé ou à défaut sur le sol) ;
- assise en cas de gêne respiratoire ;
- en laissant la partie brûlée visible si possible ;
- surveiller continuellement.
NB : Aucun produit ne doit être appliqué sur une brûlure grave sans avis médical.
… face à une brûlure simple :
– poursuivre le refroidissement jusqu’à disparition de la douleur ;
– ne jamais percer les cloques ;
– protéger les cloques par un pansement stérile ;
– demander un avis médical ou d’un autre professionnel de santé :
- pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique ;
- s’il s’agit d’un enfant ou d’un nourrisson ;
- en cas d’apparition dans les jours qui suivent de fièvre, d’une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse.
Conduites à tenir particulières
En présence d’une brûlure par produits chimiques :
– rincer immédiatement et abondamment à l’eau courante tempérée, suivant les consignes données lors de l’alerte des secours :
- l’ensemble du corps en cas de projection sur les vêtements ou la peau ;
- l’œil, s’il est atteint, en veillant à ce que l’eau de lavage ne coule pas sur l’autre œil.
– ôter les vêtements imbibés de produits, en se protégeant ;
– ne jamais faire vomir ou boire, en cas d’ingestion de produit chimique ;
– conserver l’emballage du produit en cause ;
– se laver les mains après avoir réaliser les gestes de secours.
En présence d’une brûlure électrique :
– ne jamais toucher la victime avant la suppression du risque ;
– arroser la zone visiblement brûlée à l’eau courante tempérée ;
– faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.
En présence d’une brûlure interne par inhalation de vapeurs chaudes ou caustiques :
– en cas de difficultés respiratoires, placer la victime en position assise ;
– faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.
HÉMORRAGIES EXTERNES
Version : 2.1.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui provient d’une plaie ou d’un orifice naturel et qui ne s’arrête pas spontanément. Elle imbibe de sang un mouchoir de tissu ou de papier en quelques secondes.
Un saignement dû à une écorchure, une éraflure ou une abrasion cutanée, qui s’arrête spontanément n’est pas une hémorragie.
Le plus souvent, il est facile de constater une hémorragie. Toutefois, celle-ci peut temporairement être masquée par la position de la victime ou un vêtement particulièrement absorbant (manteau, blouson…).
Causes
L’hémorragie est généralement secondaire à un traumatisme comme un coup, une chute, une plaie par un objet tranchant (couteau), un projectile (une balle) ou une maladie comme la rupture de varice chez la personne âgée.
Risques
Les risques d’une perte abondante ou prolongée de sang sont :
– pour la victime : d’entraîner une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque par une diminution importante de la quantité de sang dans l’organisme ;
– pour le sauveteur : d’être infecté par une maladie transmissible s’il présente des effractions cutanées (plaies, piqûres) ou en cas de projection sur les muqueuses (bouche, yeux).
Principes d’action
Le sauveteur doit arrêter ou limiter la perte de sang de la victime et retarder l’installation d’une détresse qui peut entraîner la mort.
Conduite à tenir
– constater l’hémorragie, si nécessaire en écartant les vêtements ;
– demander à la victime de comprimer immédiatement l’endroit qui saigne ou à défaut, le faire à sa place ;
– allonger confortablement la victime, par exemple sur un lit, un canapé ou à défaut sur le sol [3] ;
– alerter les secours. L’alerte est réalisée par :
- un témoin s’il est présent ;
- le sauveteur si la victime comprime elle même la plaie ;
- le sauveteur, après avoir relayé la compression directe (réalisée par lui même) par un pansement compressif ;
– si le saignement se poursuit, reprendre la compression directe par dessus l’éventuel pansement compressif ;
– si la compression directe d’une hémorragie d’un membre est inefficace (le saignement persiste malgré tout) ou impossible (nombreuses victimes, catastrophes, situations de violence collective ou de guerre, nombreuses lésions, plaie inaccessible, corps étranger), mettre en place un garrot au dessus de la plaie pour arrêter le saignement ;
– rassurer la victime, en lui parlant régulièrement et en lui expliquant ce qui se passe ;
– protéger la victime contre la chaleur, le froid ou les intempéries, la réchauffer si nécessaire ;
– surveiller l’apparition de signes d’aggravation.
Dans tous les cas, si l’état de la victime s’aggrave (sueurs abondantes, sensation de froid, pâleur intense, perte de connaissance) :
– contacter à nouveau les secours pour signaler l’aggravation ;
– pratiquer les gestes qui s’imposent si la victime a perdu connaissance ou présente un arrêt cardiaque.
Conduites à tenir particulières
En présence d’une victime qui saigne du nez :
– l’asseoir, tête penchée en avant (ne jamais l’allonger) ;
– lui demander de se moucher vigoureusement ;
– lui demander de comprimer les deux narines avec les doigts, durant 10 minutes sans relâcher ;
– demander un avis médical si :
- le saignement ne s’arrête pas ou se reproduit ;
- le saignement survient après une chute ou un coup ;
- la victime prend des médicaments, en particulier ceux qui augmentent les saignements.
En présence d’une victime qui vomit ou crache du sang :
Il s’agit d’un signe pouvant traduire une maladie grave nécessitant une prise en charge médicale.
– Installer la victime dans la position :
- où elle se sent le mieux si elle est consciente ;
- allongée, en position stable sur le côté si elle a perdu connaissance ;
– faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes ;
– surveiller en permanence.
En présence d’une victime qui perd du sang par un orifice naturel (sauf le nez) et de façon inhabituelle :
- allonger la victime ;
- faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.
En cas d’aggravation :
- contacter à nouveau les secours pour signaler l’aggravation ;
- pratiquer les gestes qui s’imposent si la victime a perdu connaissance.
Contact du sauveteur avec le sang de la victime
Si le sauveteur risque d’entrer en contact avec le sang de la victime, il doit si possible :
- se protéger par le port de gants ;
- à défaut glisser sa main dans un sac plastique.
En cas de contact avec le sang d’une victime :
- ne pas porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux ;
- ne pas manger avant de s’être lavé les mains et de s’être changé ;
- retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible après la fin de l’action de secours ;
- se laver les mains ou toute zone souillée par le sang de la victime ;
- se désinfecter (gel hydro-alcoolique, dakin…)
- demander un avis médical, sans délai si le sauveteur :
- présente une plaie, même minime, ayant été souillée ;
- a subi une projection sur le visage.
MALAISE
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
Le malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l’organisme, sans pouvoir en identifier obligatoirement l’origine. Cette sensation, parfois répétitive, peut être fugace ou durable, de survenue brutale ou progressive.
La victime, consciente, ne se sent pas bien et présente des signes inhabituels.
Causes
Le malaise peut avoir diverses origines : maladies, intoxications, allergies…
Risques
Certains signes doivent être rapidement reconnus car la prise en charge de la victime est urgente en service spécialisé pour éviter des séquelles définitives ou une évolution fatale.
Certains signes, apparemment sans gravité, peuvent être révélateurs d’une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale.
Principes d’action
Le sauveteur, après avoir mis la victime au repos, doit recueillir en écoutant et en observant, les informations à transmettre pour obtenir un avis médical.
Conduite à tenir
– observer les signes d’apparition soudaine, isolés ou associés, même de très courte durée, qui peuvent orienter le médecin vers :
- un accident cardiaque : douleur dans la poitrine ;
- un accident vasculaire cérébral (AVC) :
- faiblesse ou paralysie d’un bras ;
- déformation de la face ;
- perte de la vision d’un œil ou des deux ;
- difficulté de langage (incohérence de la parole) ou de compréhension ;
- mal de tête sévère, inhabituel ;
- perte d’équilibre, instabilité de la marche ou chute inexpliquée.
Ces deux pathologies imposent une prise en charge urgente.
- un autre type de malaise, la victime se plaint :
- d’une douleur abdominale intense ;
- d’une difficulté à respirer ou à parler ;
- d’une sensation de froid et présente des sueurs abondantes ou une pâleur intense.
– mettre au repos en position :
- allongée confortablement par exemple sur un lit ou un canapé, ou à défaut sur le sol ;
- assise en cas de difficultés à respirer ;
- sinon, dans la position où elle se sent le mieux.
– desserrer les vêtements, en cas de gêne.
– rassurer la victime en lui parlant régulièrement.
– protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries.
– se renseigner auprès de la victime ou de son entourage sur :
- son âge ;
- la durée du malaise ;
- son état de santé actuel (maladies, hospitalisations ou traumatisme récents) ;
- les traitements médicamenteux qu’elle prend ;
- la survenue d’un malaise identique par le passé.
– à sa demande, lui donner :
- son traitement habituel pour ce malaise ;
- du sucre en morceaux.
– demander un avis médical et transmettre les informations recueillies (souvent le médecin régulateur demande à parler directement à la victime) puis appliquer les consignes.
En cas d’aggravation en attendant les secours :
– contacter à nouveau les services de secours pour signaler l’aggravation ;
– pratiquer les gestes qui s’imposent, si elle est a perdu connaissance.
OBSTRUCTION AIGUË DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
L’obstruction des voies aériennes est la gêne ou l’empêchement brutal des mouvements de l’air entre l’extérieur et les poumons. Elle est qualifiée :
– d’obstruction partielle, lorsque la respiration reste efficace. La victime :
- peut parler ou crier ;
- tousse vigoureusement ;
- respire, parfois avec un bruit surajouté.
– d’obstruction totale, lorsque la respiration n’est plus efficace, voire impossible. La victime :
- ne peut plus parler, crier, tousser ou émettre un son ;
- garde la bouche ouverte ;
- s’agite, devient rapidement bleue puis perd connaissance.
Causes
Les corps étrangers qui sont le plus souvent à l’origine d’une obstruction aiguë des voies aériennes sont les aliments (noix, cacahuètes, carottes) ou des objets (aimants de magnets, jouets).
L’obstruction, particulièrement fréquente chez l’enfant, se produit le plus souvent lorsque la personne est en train de manger, de boire ou de porter un objet à la bouche.
Risques
En l’absence de gestes de secours efficaces, le risque d’une obstruction des voies aériennes par un corps étranger est de mettre en jeu immédiatement la vie de la victime, ou d’entraîner des complications respiratoires graves.
Principes d’action
L’action du sauveteur doit permettre :
- de désobstruer les voies aériennes si elles sont totalement bouchées ;
- d’empêcher toute aggravation en cas d’obstruction partielle.
Conduite à tenir
En présence d’une victime présentant une obstruction partielle :
- ne jamais pratiquer de technique de désobstruction ;
- installer la victime dans la position où elle se sent le mieux ;
- l’encourager à tousser [4] ;
- demander un avis médical et appliquer les consignes ;
- surveiller attentivement la victime.
Si l’obstruction devient totale, il convient d’appliquer la conduite à tenir devant une obstruction totale.
En présence d’une victime présentant une obstruction totale :
- donner des claques dans le dos ;
- réaliser des compressions en cas d’inefficacité des « claques dans le dos » :
- au niveau abdominal s’il s’agit d’un adulte ou d’un enfant ;
- au niveau thoracique s’il s’agit d’un nourrisson ;
- au niveau thoracique s’il s’agit d’un adulte obèse ou d’une femme enceinte lorsqu’il est impossible d’encercler l’abdomen ;
- répéter le cycle « claques dans le dos » et « compressions » ;
- interrompre les manœuvres dès :
- l’apparition d’une toux, de cris ou de pleurs ;
- la reprise de la respiration ;
- le rejet du corps étranger.
Si les manœuvres de désobstruction sont efficaces :
- installer dans la position où elle se sent le mieux ;
- réconforter en lui parlant régulièrement ;
- desserrer les vêtements ;
- faire ou alerter les secours et appliquer leurs consignes ;
- surveiller la victime.
Si la victime perd connaissance :
- l’accompagner au sol ;
- faire alerter ou alerter les secours ;
- réaliser une réanimation cardio-pulmonaire ;
- vérifier la présence du corps étranger dans la bouche à la fin de chaque cycle de compressions thoraciques. Le retirer prudemment s’il est accessible.
PERTE DE CONNAISSANCE
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
Une personne a perdu connaissance lorsqu’elle ne répond et ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique et respire.
Causes
Les causes de cette perte de connaissance peuvent être d’origine traumatique, médicale ou toxique.
Risques
Le risque de la perte de connaissance est d’évoluer vers l’arrêt respiratoire et l’arrêt cardiaque. En effet, la respiration n’est possible que si les voies aériennes permettent le passage de l’air sans encombre.
Une personne qui a perdu connaissance, laissée sur le dos, est toujours exposée à des difficultés respiratoires, du fait de l’encombrement ou de l’obstruction des voies aériennes par :
- des liquides présents dans la gorge (salive, sang, liquide gastrique) ;
- la chute de la langue en arrière.
Principes d’action
Le sauveteur doit assurer la liberté des voies aériennes de la victime afin de permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur en attendant l’arrivée des secours.
Conduite à tenir
– Apprécier l’état de conscience de la victime et pour cela :
- poser des questions simples (« Comment ça va ? », « Vous m’entendez ? ») ;
- secouer doucement les épaules ou lui prendre la main et demander d’exécuter un ordre simple (« Serrez-moi la main »...) ;
Si la victime répond ou réagit : elle est consciente. Il convient d’adopter la conduite à tenir adaptée au malaise.
Si la victime ne répond pas et ne réagit pas, il convient de :
- demander de l’aide, si vous êtes seul ;
- allonger la victime sur le dos ;
- libérer les voies aériennes ;
- apprécier la respiration sur 10 secondes au plus. Pour cela :
- maintenir la libération des voies aériennes ;
- se pencher sur la victime, oreille et joue du sauveteur au-dessus de la bouche et du nez de la victime puis :
- regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
- écouter d’éventuels sons provoqués par la respiration ;
- sentir un éventuel flux d’air à l’expiration.
En présence d’une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire (perte de connaissance) :
- la placer en position stable sur le côté (Position latérale de sécurité) ;
- faire alerter ou alerter les secours ;
- surveiller en permanence la respiration de la victime, jusqu’à l’arrivée des secours. Pour cela :
- regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
- écouter d’éventuels sons provoqués par la respiration ;
- sentir, avec le plat de la main, le soulèvement du thorax.
- protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries.
Si la victime ne respire pas ou si sa respiration s’arrête ou devient anormale, il convient d’adopter la conduite à tenir face à un arrêt cardiaque et de prévenir les secours de l’évolution.
PLAIES
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
La plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec une atteinte possible des tissus situés dessous. Elle est qualifiée de :
– plaie simple, lorsqu’il s’agit d’une petite coupure superficielle, d’une éraflure saignant peu ;
– plaie grave du fait :
- d’une hémorragie associée ;
- d’un mécanisme pénétrant : objet tranchant ou perforant, morsures, projectiles ;
- de sa localisation : thoracique, abdominale, oculaire ou proche d’un orifice naturel ;
- de son aspect : déchiqueté, écrasé.
Causes
La plaie est généralement secondaire à un traumatisme, elle est provoquée par une coupure, une éraflure, une morsure ou une piqûre.
Risques
Une plaie, suivant son importance et sa localisation, peut être à l’origine d’une aggravation immédiate de l’état de la victime par hémorragie ou par défaillance de la respiration.
Elle peut être aussi à l’origine d’une infection secondaire dont le tétanos.
Le tétanos est une maladie très grave, parfois mortelle. Seule la vaccination antitétanique protège de cette maladie.
Principes d’action
Le sauveteur doit identifier la gravité de la plaie afin d’adopter une conduite à tenir adaptée.
Conduite à tenir
Evaluer la gravité de la plaie, puis…
… face à une plaie grave :
- ne jamais retirer le corps étranger (couteau, morceau de verre…) [5] ;
- en cas d’hémorragie, arrêter le saignement (cf. hémorragies externes) ;
- si la plaie est située au niveau du thorax, la laisser à l’air libre ;
- installer confortablement et sans délai la victime en position d’attente, par exemple sur un lit ou un canapé, ou à défaut sur le sol :
- assise [6] en présence d’une plaie au thorax ;
- allongée [7], jambes fléchies [8] en présence d’une plaie de l’abdomen ;
- allongée, yeux fermés [9] en demandant de ne pas bouger la tête en présence d’une plaie à l’œil et si possible en maintenant sa tête à deux mains ;
- allongée [10] dans tous les autres cas.
- protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries ;
- faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes ;
- réconforter la victime en lui parlant régulièrement et en lui expliquant ce qui se passe ;
- surveiller la victime.
… face à une plaie simple :
- se laver les mains à l’eau et au savon ;
- nettoyer la plaie en rinçant abondamment à l’eau courante, avec ou sans savon [11], en s’aidant d’une compresse si besoin pour enlever les souillures ;
- désinfecter à l’aide d’un antiseptique, éventuellement ;
- protéger par un pansement adhésif ;
- conseiller de consulter un médecin ou un autre professionnel de santé :
- pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique ;
- en cas d’apparition dans les jours qui suivent de fièvre, d’une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse.
PROTECTION
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Protection d’une personne exposée à un danger
Une victime ou toute autre personne menacée par un danger doit en être protégée, notamment du sur-accident. Pour cela, le sauveteur, lorsqu’il peut agir sans risque pour sa propre sécurité doit immédiatement supprimer ou écarter le danger de façon permanente.
Si nécessaire, cette première mesure est complétée en délimitant clairement et largement la zone de danger, de façon visible, afin d’éviter toute intrusion dans la zone. Cette délimitation se fait en utilisant tous les moyens matériels à disposition ainsi que le concours des personnes aptes aux alentours.
Dégagement d’urgence d’une victime
Lorsque la victime ne peut se soustraire d’elle-même à un danger réel, immédiat et non contrôlable, un dégagement d’urgence peut être alors réalisé par le sauveteur. Cette manœuvre peut être dangereuse pour la victime ou lui-même. Elle doit donc rester exceptionnelle.
Le dégagement d’urgence de la victime doit alors permettre de placer celle-ci dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.
Aucune technique n’est imposée lors de la réalisation d’un dégagement d’urgence.
Toutefois, lors de sa réalisation, le sauveteur s’engage par le cheminement le plus sûr et le plus rapide seulement si la victime est visible, facile à atteindre et que rien ne gêne son dégagement. Il assure son extraction en fonction de ses capacités.
Devant une attaque terroriste ou situation de violence
Devant une attaque terroriste ou une situation de violence, le sauveteur tentera d’appliquer les consignes nationales éditées par le ministère de l’intérieur et disponibles en ligne « réagir en cas d’attaque terroriste ».
Ainsi, la conduite à tenir pour le sauveteur avant l’arrivée des forces de l’ordre pourrait être la suivante : s’échapper, si c’est impossible se cacher, alerter et obéir aux forces de l’ordre, réaliser les gestes de premiers secours, rester vigilant.
TRAUMATISME
Version : 2.1.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Définition — Signes
Les atteintes traumatiques sont des lésions des os (fractures), des articulations (entorses ou luxations), des organes ou de la peau. Pour une meilleure compréhension, ce dernier type d’atteinte fait l’objet d’un traitement spécifique (Cf. Brûlures et plaies).
Elles peuvent provoquer immédiatement une douleur vive, une difficulté ou une impossibilité de bouger, éventuellement accompagnées d’un gonflement ou d’une déformation de la zone atteinte.
Lorsque le choc se situe au niveau de la tête, du thorax ou de l’abdomen, une atteinte des organes sous-jacents est toujours possible et peut se révéler secondairement par d’autres signes (perte de connaissance, maux de tête persistants, vomissements, agitation, somnolence, douleur abdominale…).
Lorsque le traumatisme se situe au niveau de la colonne vertébrale (douleur du dos ou de la nuque), une atteinte de la moelle épinière est possible.
Causes
Les traumatismes peuvent être le résultat d’un choc, d’un coup, d’une chute ou d’un faux mouvement et peuvent atteindre toutes les parties du corps.
Risques
Les risques, lors d’une atteinte traumatique, sont d’entrainer des complications neurologiques (paralysie, trouble de la conscience ou perte de connaissance), respiratoires (gêne ou détresse) ou circulatoires (détresse).
Principes d’action
Le sauveteur ne doit pas mobiliser la victime.
Conduite à tenir
Si la victime a perdu connaissance :
- adopter la conduite à tenir face à une perte de connaissance.
Si la victime est consciente et présente immédiatement des signes :
- conseiller fermement de ne pas mobiliser la partie atteinte ;
- faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes ;
- protéger de la chaleur, du froid ou des intempéries ;
- surveiller la victime et lui parler régulièrement.
Si la victime présente une douleur du cou à la suite d’un traumatisme (suspicion de traumatisme du rachis cervical) :
- demander à la victime de ne pas bouger la tête ;
- faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes ;
- si possible stabiliser le rachis cervical dans la position où il se trouve en maintenant sa tête à deux mains ;
- surveiller la victime et lui parler régulièrement.
Si la victime présente une fracture de membre déplacée, ne pas tenter de la réaligner.
FICHE TECHNIQUE N° 1 COMPRESSION LOCALE
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
La compression locale est indiquée sur toute plaie qui saigne abondamment.
JUSTIFICATION
La compression des vaisseaux sanguins, au niveau d’une plaie arrête le saignement.
Par compression directe
– Appuyer fortement sur l’endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main, en interposant une épaisseur de tissu propre recouvrant complètement la plaie (mouchoirs, torchons, vêtements…) et ce jusqu’à l’arrivée des secours.
En l’absence de tissu, la victime si elle le peut ou le sauveteur, appuie directement avec sa main.
Par pansement compressif
Si le sauveteur doit se libérer et que la victime ne peut pas appuyer elle-même sur la plaie qui saigne, il remplace la compression directe qu’il réalise par une épaisseur de tissu propre recouvrant complètement la plaie (mouchoirs, torchons, vêtements…) fixée par une bande élastique ou un lien large assez long pour serrer suffisamment et arrêter ainsi le saignement.
Le remplacement de cette compression est impossible lorsque l’endroit qui saigne est situé au niveau du cou, de la tête, du thorax ou de l’abdomen.
POINTS CLEFS
La compression locale doit être :
– suffisante pour arrêter le saignement ;
– permanente.
FICHE TECHNIQUE N° 2 COMPRESSIONS THORACIQUES
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en présence d’une victime en arrêt cardiaque.
JUSTIFICATION
Cette technique permet d’oxygéner les organes d’une victime en arrêt cardiaque en rétablissant une circulation artificielle.
Quel que soit l’âge de la victime, il convient de :
- l’installer en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide ;
- se placer auprès d’elle, le plus souvent à genoux ;
- dénuder la poitrine de la victime, dans la mesure du possible.
Chez l’adulte
– placer le talon d’une main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum ;
– placer l’autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des deux mains pour éviter d’appuyer sur les côtes ;
– réaliser des compressions sternales d’environ 5 cm sans dépasser 6 cm tout en veillant à :
- conserver les bras parfaitement verticaux ;
- tendre les bras ;
- verrouiller les coudes ;
- maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute.
- assurer un temps de compression égal à celui du relâchement [12] ;
- entre chaque compression, laisser le thorax reprendre sa forme initiale, sans décoller les mains.
Chez l’enfant
– placer le talon d’une main un travers de doigt au-dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes ;
– relever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes ;
– réaliser les compressions sternales comme chez l’adulte en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur soit environ 5 cm.
Si la victime (enfant) est grand ou si le sauveteur est petit et n’a pas suffisamment de force, il peut être utile d’utiliser la même technique que chez l’adulte.
Chez le nourrisson
– Placer la pulpe de deux doigts d’une main dans l’axe du sternum, un travers de doigt au-dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes ;
– réaliser les compressions sternales à l’aide de la pulpe des deux doigts en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de l’épaisseur soit environ 4 cm.
POINTS CLEFS
Les compressions thoraciques doivent :
– comprimer fortement le sternum ;
– avoir une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute.
FICHE TECHNIQUE N° 3 DÉFIBRILLATION
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en présence d’une victime en arrêt cardiaque.
JUSTIFICATION
Cette technique peut permettre de retrouver une activité cardiaque normale. Elle est sûre et sans risque même si elle est utilisée par des personnes qui sont peu ou pas formées.
Le DAE doit être utilisé en suivant toutes les indications de l’appareil (schéma, messages vocaux).
Si plus d’un sauveteur est présent, la RCP doit être poursuivie durant l’installation du DAE. Les compressions thoraciques doivent être interrompues seulement lorsque le DAE indique de ne plus toucher à la victime.
Chez l’adulte
– Mettre en fonction le défibrillateur ;
– suivre les indications de l’appareil [13] ;
Ces indications précisent, dans un premier temps, de mettre en place les électrodes. Pour cela :
- enlever ou couper les vêtements recouvrant la poitrine de la victime, si nécessaire ;
- sécher le thorax de la victime s’il est humide ;
- déballer et appliquer les électrodes, sur la poitrine nue de la victime, dans la position indiquée sur le schéma figurant sur l’emballage ou sur les électrodes ;
- connecter les électrodes au défibrillateur, si nécessaire.
Lorsque le DAE l’indique, ne plus toucher la victime et s’assurer que les personnes aux alentours fassent de même [14].
Si le défibrillateur annonce que le choc est nécessaire :
- demander aux personnes aux alentours de s’écarter ;
- laisser le DAE déclencher le choc électrique (défibrillateur entièrement automatique) ou appuyer sur le bouton « choc » lorsque l’appareil le demande (défibrillateur semi-automatique) ;
- reprendre immédiatement les compressions thoraciques après la délivrance du choc.
Si le défibrillateur annonce que le choc n’est pas nécessaire :
- reprendre immédiatement les compressions thoraciques.
Chez l’enfant ou le nourrisson
La défibrillation doit être réalisée avec des appareils adaptés (électrodes enfants, réducteur d’énergie…).
En l’absence d’un DAE adapté, un DAE « Adulte » peut être utilisé. Les électrodes adultes sont alors positionnées en avant au milieu du thorax pour l’une et au milieu du dos pour l’autre.
POINTS CLEFS
La mise en œuvre du défibrillateur doit :
– être la plus précoce possible ;
– interrompre le moins possible la pratique des compressions thoraciques.
FICHE TECHNIQUE N° 4 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES CLAQUES DANS LE DOS
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en cas d’obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger.
JUSTIFICATION
Le but de la claque dans le dos est de provoquer un mouvement de toux pour débloquer et expulser le corps étranger qui obstrue les voies aériennes.
La technique de désobstruction des voies aériennes varie en fonction du gabarit de la victime.
Chez l’adulte et le grand enfant
– laisser la victime debout ou assise ;
– se placer sur le côté et légèrement en arrière de la victime ;
– soutenir le thorax avec une main ;
– pencher la victime vers l’avant ;
– donner de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de la main ouverte.
Chez la victime qui peut tenir sur la cuisse du sauveteur
– s’asseoir ;
– basculer la victime sur sa cuisse, la face vers le bas ;
– donner de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de la main ouverte.
Chez la victime qui peut tenir sur l’avant-bras du sauveteur (nourrisson, petit enfant)
– coucher la victime à califourchon sur l’avant bras, la face vers le sol ;
– maintenir sa tête avec les doigts, de part et d’autre, au niveau de l’angle de la mâchoire inférieure, sans appuyer sur la gorge ;
– incliner la victime afin que la tête soit plus basse que le thorax ;
– donner 1 à 5 claques, entre les deux omoplates, avec le talon de la main ouverte.
POINTS CLEFS
La claque doit être donnée :
– entre les 2 omoplates ;
– avec le talon de la main ouverte ;
– de façon vigoureuse.
FICHE TECHNIQUE N° 5 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES COMPRESSIONS ABDOMINALES
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en cas d’obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger chez un adulte ou un enfant après une série de 5 claques dans le dos inefficaces, et si le sauveteur peut se tenir debout ou à genou derrière elle.
JUSTIFICATION
Le but de cette technique est de comprimer l’air contenu dans les poumons de la victime afin d’expulser le corps étranger par un effet de « piston ». Suivant l’importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions successives peuvent être nécessaires pour l’expulser.
Chez l’adulte ou l’enfant
– Se placer debout ou à genoux (enfant) derrière la victime, contre son dos ;
– passer ses bras, sous ceux de la victime, de part et d’autre de la partie supérieure de son abdomen ;
– pencher la victime vers l’avant ;
– mettre le poing sur la partie supérieure de l’abdomen, au creux de l’estomac, au-dessus du nombril et en dessous du sternum ;
– placer la seconde main sur la première, les avant-bras n’appuyant pas sur les côtes ;
– tirer franchement en exerçant une pression vers l’arrière et vers le haut ;
– effectuer de 1 à 5 compressions, en relâchant entre chacune.
POINTS CLEFS
La compression doit être faite :
– au creux de l’estomac ;
– sans appuyer sur les côtes ;
– vers l’arrière et vers le haut.
FICHE TECHNIQUE N° 6 DÉSOBSTRUCTION PAR LA MÉTHODE DES COMPRESSIONS THORACIQUES
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
Impossibilité d’encercler l’abdomen de la victime
INDICATION
Cette technique est indiquée en cas d’obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger, lorsqu’il est impossible d’encercler l’abdomen de la victime (obèse, femme enceinte dans les derniers mois de grossesse…) et après une série de 5 claques dans le dos inefficaces.
JUSTIFICATION
Le but de cette technique est de comprimer l’air contenu dans les poumons de la victime et d’expulser le corps étranger par un effet de « piston ». Suivant l’importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions successives peuvent être nécessaires pour l’expulser.
– Se positionner derrière la victime ;
– placer ses avant-bras sous les bras de la victime et encercler la poitrine de la victime ;
– mettre un poing au milieu du sternum, sans appuyer sur la pointe inférieure du sternum ;
– placer l’autre main sur la première sans appuyer les avant-bras sur les côtes ;
– tirer franchement en exerçant une pression vers l’arrière ;
– effectuer de 1 à 5 compressions, en relâchant entre chacune.
Cas particuliers
chez la victime consciente et alitée qui présente une obstruction totale des voies aériennes, le sauveteur peut réaliser des compressions thoraciques comme pour le massage cardiaque.
POINTS CLEFS
Les compressions thoraciques doivent être :
– au milieu du sternum ;
– sans appuyer sur les côtes ;
– vers l’arrière.
Chez le nourrisson
INDICATION
Cette technique est indiquée en cas d’obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger, chez une victime qui peut tenir sur l’avant-bras du sauveteur, et immédiatement après une série de 5 claques dans le dos inefficaces.
JUSTIFICATION
Le but de cette technique est de comprimer l’air contenu dans les poumons de la victime afin d’expulser le corps étranger par un effet de « piston ». Suivant l’importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions successives peuvent être nécessaires pour l’expulser.
– placer l’avant-bras contre le dos du nourrisson, la main soutenant sa tête ;
– tourner le nourrisson pour que sa face soit côté ciel ;
– placer l’avant-bras, sur lequel repose le nourrisson, sur la cuisse du sauveteur. La tête du nourrisson doit être plus basse que le reste du corps ;
– placer la pulpe de deux doigts d’une main dans l’axe du sternum, un travers de doigt au-dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes ;
– effectuer de 1 à 5 compressions profondes et successives en relâchant entre chacune.
POINTS CLEFS
Les compressions thoraciques doivent être :
– pratiquées au milieu de la poitrine ;
– profondes.
FICHE TECHNIQUE N° 7 GARROT
Version : 2.1.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en cas d’hémorragie d’un membre lorsque la compression directe est inefficace ou impossible.
JUSTIFICATION
Le but de cette technique est d’arrêter une hémorragie externe en interrompant totalement la circulation du sang du membre, en aval de l’endroit où il est posé.
Matériel
– Lien de toile, solide, non élastique, improvisé de 3 à 5 cm de large et d’environ 1,50 m de longueur (cravate, écharpe, foulard, chemise) ;
– Barre, pièce longue de 10 à 20 cm environ en bois solide, PVC dur ou métal rigide pour permettre le serrage.
NB : il existe dans le commerce des garrots spécialement conçus qui peuvent faire éventuellement parti d’une trousse de secours. Les garrots équipés d’une barre de serrage, d’un lien large et d’un dispositif de sécurité ont montré une meilleure efficacité. Il ne faut pas utiliser les garrots élastiques prévus pour les prises de sang.
Réalisation :
Le garrot est mis en place à quelques centimètres au-dessus de la plaie, jamais sur une articulation :
- faire deux tours autour du membre avec le lien large à l’endroit où le garrot doit être placé ;
- faire un nœud ;
- placer au dessus du nœud la barre et faire deux nœuds par dessus pour la maintenir ;
- tourner la barre de façon à serrer le garrot jusqu’à l’arrêt du saignement et maintenir le serrage même si la douleur provoquée est intense.
NB : En l’absence de barre, faire le garrot uniquement avec le lien large. Serrer le nœud du garrot le plus fortement possible en tirant sur chaque extrémité du lien et réaliser un double nœud de maintien.
Une fois mis en place, le garrot doit toujours rester visible (ne pas le recouvrir) et ne jamais être retiré sans avis médical.
POINTS CLEFS
Le garrot doit :
– être situé en amont de la plaie qui saigne ;
– être serré pour arrêter le saignement.
FICHE TECHNIQUE N° 8 INSUFFLATIONS
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée en présence d’une victime en arrêt cardiaque.
JUSTIFICATION
Cette technique permet d’apporter de l’air aux poumons d’une victime en arrêt cardiaque.
La victime étant préalablement installée en position horizontale et sur le dos :
Chez l’adulte et l’enfant
– basculer la tête de la victime en arrière comme pour la technique de libération des voies aériennes ;
– pincer le nez de la victime entre le pouce et l’index, tout en maintenant la bascule en arrière de la tête [15] avec la main qui est placée sur le front ;
– ouvrir légèrement la bouche de la victime en utilisant l’autre main et maintenir le menton élevé ;
– inspirer, sans excès ;
– appliquer la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement [16] ;
– insuffler progressivement jusqu’à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever (durant 1 seconde environ) ;
– se redresser légèrement tout en maintenant la bascule de la tête en arrière afin de :
- reprendre son souffle ;
- vérifier l’affaissement de la poitrine de la victime ;
– insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions.
La durée de réalisation de ces deux insufflations successives ne doit pas excéder 5 secondes [17].
Si le ventre ou la poitrine de la victime ne se soulève pas lors des insufflations :
- s’assurer que la tête de la victime est en bonne position et que son menton est élevé ;
- s’assurer qu’il y a une bonne étanchéité et pas de fuite d’air lors de l’insufflation ;
- rechercher la présence d’un corps étranger dans la bouche. Le retirer avec les doigts, si nécessaire.
Chez le nourrisson
La technique est sensiblement la même que pour l’adulte ou l’enfant. Toutefois, il convient de :
- placer la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé ;
- englober avec la bouche à la fois la bouche et le nez de la victime ;
- insuffler progressivement jusqu’à ce que la poitrine du nourrisson commence à se soulever (durant 1 seconde environ) ;
- se redresser légèrement tout en maintenant la tête en position neutre afin de :
- reprendre son souffle ;
- vérifier l’affaissement de la poitrine de la victime ;
- insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions.
POINTS CLEFS
Les deux insufflations doivent :
– être lentes et progressives ;
– cesser dès le début de soulèvement de la poitrine ;
– être réalisées en 5 secondes au maximum.
FICHE TECHNIQUE N° 9 LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES
Version : 1.1.2 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique doit être réalisée systématiquement avant de pouvoir apprécier la respiration chez une victime qui ne répond ou ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique.
JUSTIFICATION
La bascule de la tête en arrière (chez l’adulte ou l’enfant) ou la mise en position neutre (chez le nourrisson) et l’élévation du menton entraînent la langue qui, en se décollant du fond de la gorge, permet le passage de l’air.
– placer la paume d’une main sur le front de la victime ;
– placer 2 ou 3 doigts de l’autre main, juste sous la pointe du menton en prenant appui sur l’os. Eventuellement s’aider du pouce pour saisir le menton ;
Chez l’adulte ou l’enfant
– basculer doucement la tête de la victime en arrière en appuyant sur le front et élever le menton.
Chez le nourrisson
– amener doucement la tête du nourrisson en position neutre dans l’alignement du torse et élever le menton tout en évitant une bascule excessive susceptible de provoquer une extension du rachis et une gène de la ventilation.
POINTS CLEFS
La liberté des voies aériennes est assurée lorsque :
– le menton est élevé ;
– la tête est maintenue dans cette position.
FICHE TECHNIQUE N° 10 MAINTIEN DE LA TÊTE
Version : 2.1.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée chez la victime qui présente une douleur du cou à la suite d’un traumatisme (suspicion du traumatisme du rachis cervical), ou une plaie à l’œil.
JUSTIFICATION
Le maintien de la tête du blessé à deux mains permet de la stabiliser et de limiter les mouvements intempestifs du cou.
– se placer en position stable à genou ou en trépied dans l’axe de la victime, au niveau de sa tête ;
– placer les deux mains de chaque côté de sa tête pour la maintenir dans la position où elle se trouve.
Pour diminuer la fatigue, il est possible de prendre appui avec les coudes sur le sol ou sur les genoux.
POINTS CLEFS
Le maintien de la tête est efficace lorsque :
– le sauveteur est en position stable ;
– le maintien de la tête limite ses mouvements.
FICHE TECHNIQUE N° 11 POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ
Version : 1.2.1 Mise à jour : – Janvier 2017 —
INDICATION
Cette technique est indiquée chez la victime qui ne répond ou ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique et respire.
JUSTIFICATION
La position latérale de sécurité permet de maintenir libres les voies aériennes supérieures de la victime en permettant l’écoulement des liquides vers l’extérieur et en évitant que la langue ne chute dans le fond de la gorge.
Chez l’adulte ou l’enfant
1er temps : Préparer le retournement de la victime. Pour cela :
– retirer les lunettes de la victime si elle en porte ;
– rapprocher délicatement les membres inférieurs de l’axe du corps ;
– placer le bras de la victime, situé du côté sauveteur, à angle droit de son corps ;
– plier le coude de ce même bras en gardant la paume de la main de la victime tournée vers le haut [18] ;
– se placer à genoux ou en trépied à côté de la victime, au niveau de son thorax ;
– saisir le bras opposé de la victime et amener le dos de la main de la victime sur son oreille, côté sauveteur ;
– maintenir le dos de la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume [19] ;
– attraper la jambe opposée de la victime, avec l’autre main, juste derrière le genou ;
– relever la jambe de la victime, tout en gardant le pied au sol [20] ;
– s’éloigner du thorax de la victime afin de pouvoir la retourner sans avoir à reculer, si nécessaire ;
2e temps : Retourner la victime. Pour cela :
– tirer sur la jambe relevée de la victime afin de la faire pivoter vers le sauveteur, jusqu’à ce que le genou touche le sol, sans brusquerie et en un seul temps ;
– dégager doucement la main du sauveteur située sous la tête de la victime, tout en préservant la bascule de la tête en arrière, en maintenant le coude de la victime à l’aide de la main du sauveteur précédemment située au genou [21] ;
3e temps : Stabiliser la victime. Pour cela :
– ajuster la jambe de la victime située au-dessus de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit [22] ;
– ouvrir la bouche de la victime sans mobiliser la tête et sans rabattre le menton sur le sternum [23] ;
– contrôler en permanence la respiration.
Chez le nourrisson
– Placer le nourrisson sur le côté, dans les bras du sauveteur le plus souvent.
POINTS CLEFS
La mise en position latérale de sécurité doit :
– limiter au maximum les mouvements de la colonne vertébrale ;
– aboutir à une position stable, la plus latérale possible ;
– permettre de contrôler la respiration de la victime ;
– permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur (bouche ouverte).
FICHE MATÉRIEL N° 1 DÉFiBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE
Version : 1.1.3 Mise à jour : – Janvier 2017 —
But
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui permet :
- d’analyser l’activité électrique du cœur de la victime ;
- de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l’origine de l’arrêt cardiaque ;
- de délivrer ou d’inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique (information vocale et visuelle), afin d’arrêter l’activité électrique anarchique du cœur.
Composition
Le défibrillateur automatisé externe est composé :
- d’un haut-parleur qui donne des messages sonores et guide le sauveteur dans son action ;
- d’un métronome qui rythme les compressions thoraciques du sauveteur (en option) ;
- d’un accumulateur d’énergie qui permet de réaliser des chocs électriques ;
- éventuellement, d’un bouton qui permet de délivrer le choc électrique lorsqu’il est indiqué par l’appareil.
Le DAE est toujours accompagné d’une paire d’électrodes de défibrillation pré-gélifiées autocollantes avec câble intégré. Ces électrodes, à usage unique, sont contenues dans un emballage hermétique. Une seconde paire doit être disponible en cas de défaillance de la première.
Une fois collées sur la peau du thorax de la victime, les électrodes permettent :
- de capter et transmettre l’activité électrique cardiaque au défibrillateur ;
- de délivrer le choc électrique lorsqu’il est indiqué. Plusieurs accessoires peuvent être joints au défibrillateur dont :
- une paire de ciseaux, pour couper les vêtements et dénuder la poitrine de la victime ;
- des compresses ou du papier absorbant, pour sécher la peau de la poitrine de la victime si elle est mouillée ou humide ;
- d’un rasoir jetable pour raser les poils de la victime, s’ils sont particulièrement abondants, à l’endroit où l’on colle les électrodes.
Localisation
Actuellement, les DAE mis à disposition du public sont de plus en plus nombreux, on les trouve notamment dans :
- les halls d’aéroports et les avions des grandes compagnies aériennes ;
- les grands magasins, les centres commerciaux ;
- les halls de gares, les trains ;
- les lieux de travail ;
- certains immeubles d’habitation…
Dans ces cas, les appareils sont parfois placés dans des armoires murales repérées par un logo facilement identifiable.
Risques et contraintes
Si la victime présente un timbre autocollant médicamenteux sur la zone de pose des électrodes, le sauveteur retire le timbre et essuie la zone avant de coller l’électrode.
Si la victime présente un stimulateur cardiaque (le plus souvent le sauveteur constate une cicatrice et perçoit un boîtier sous la peau, sous la clavicule droite ou est informé par la famille) à l’endroit de pose de l’électrode, le sauveteur colle l’électrode à un travers de main de l’appareil (environ 8 cm de la bosse perçue).
Si la victime est allongée sur un sol mouillé (bord de piscine, pluie…) ou si son thorax est mouillé, le sauveteur, si possible, déplace la victime pour l’allonger sur une surface sèche et, si possible, sèche son thorax avant de débuter la défibrillation [24].
Si la victime est allongée sur une surface en métal : si c’est possible et en se faisant aider si besoin, le sauveteur déplace la victime ou glisse un tissu sous elle (couverture…) avant de débuter la défibrillation [25].
Si le DAE détecte un mouvement au cours de l’analyse, le sauveteur doit s’assurer de ne pas toucher la victime au cours de l’analyse. En l’absence de contact avec la victime, il vérifie la respiration de celle-ci.
Si le DAE demande toujours de connecter les électrodes alors que cette opération a déjà été effectuée, le sauveteur, vérifie que :
- les électrodes sont bien collées et le câble de connexion correctement connecté au DAE ;
- si le problème n’est pas résolu et qu’une seconde paire d’électrodes est disponible, remplacer les électrodes.
Notes
[1] A l’époque des téléphones portables, la transmission de l’alerte ne pose plus guère de problème. Dans le cas contraire, un sauveteur seul face à une personne en arrêt cardiaque est en grande difficulté. Il doit appeler très tôt pour donner un maximum de chance de survie à la victime.
[2] Le sauveteur récupère lui-même le DAE s’il est à proximité et qu’il peut se le procurer immédiatement sans interrompre la RCP plus de 10 secondes. Il faut pour cela que le DAE soit dans son champ visuel. Dans le cas contraire, le sauveteur réalise la RCP jusqu’à ce qu’on lui apporte le DAE.
[3] La position allongée retarde ou empêche l’installation d’une détresse liée à la perte importante de sang.
[4] Le fait d’encourager à tousser aide au rejet du corps étranger.
[5] L’interdiction de retirer le corps étranger d’une plaie évite toute aggravation de la lésion ou du saignement.
[6] La position assise facilite la respiration lorsque l’on est en présence d’une plaie au thorax.
[7] La position allongée permet de prévenir les détresses et d’éviter les complications.
[8] La flexion des jambes d’une victime préalablement allongée permet, par le relâchement des muscles de l’abdomen, de diminuer la douleur.
[9] La fermeture des yeux et l’immobilité de la tête permettent de limiter les risques d’aggravation de la lésion de l’œil.
[10] La position allongée permet de prévenir les détresses et d’éviter les complications.
[11] Le lavage à l’eau, avec ou sans savon, permet d’éliminer les germes qui pourraient provoquer une infection.
[12] Cette technique permet une efficacité maximale. Il permet au thorax de reprendre sa dimension initiale après chaque compression thoracique, afin que le cœur se remplisse bien de sang.
[13] Ces indications peuvent être vocales ou visuelles. Leur suivi strict permet de réaliser les différentes opérations plus rapidement et en sécurité.
[14] Tout mouvement de la victime durant la phase d’analyse du rythme cardiaque est susceptible de la fausser.
[15] Le pincement du nez empêchera toute fuite d’air par le nez lors des insufflations.
[16] La pression ferme autour de la bouche de la victime empêchera toute fuite d’air durant les insufflations.
[17] La réalisation rapide des manœuvres d’insufflation permet de ne pas retarder la reprise des compressions thoraciques.
[18] L’alignement des jambes et la position du membre supérieur anticipent la position finale.
[19] Lors du retournement, le maintien de la main de la victime contre son oreille permet d’accompagner le mouvement de la tête et de diminuer la flexion de la colonne cervicale qui pourrait aggraver un traumatisme éventuel.
[20] La saisie de la jambe de la victime au niveau du genou permet de l’utiliser comme « bras de levier » pour le retournement.
[21] Le maintien de la main sous la joue de la victime limite les mouvements de la colonne cervicale.
[22] La position de la jambe permet de stabiliser la PLS.
[23] L’ouverture de la bouche de la victime facilite l’écoulement des liquides vers l’extérieur.
[24] L’efficacité d’un choc électrique sur une victime allongée sur un sol mouillé est diminuée. Il n’existe pas de risque réel pour le sauveteur.
[25] L’efficacité d’un choc électrique sur une victime allongée sur une surface métallique est diminuée. Il n’existe pas de risque réel pour le sauveteur.
Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !